Août 31, 2021
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | DRAIN, MICHEL |
|---|
| Source / Fundstelle: | Centre Thycidide, Éditions Panthéon-Assas |
|---|
| Revue / Zeitschrift: | Annuaire français des relations internationales, vol. XXI, pp. 367-378 |
|---|
| Année / Jahr: | 2020 |
|---|
| Localisation / Standort: | Annuaire français des relations internationales |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Droit international public, droit politique, Politiques, économie et société |
|---|
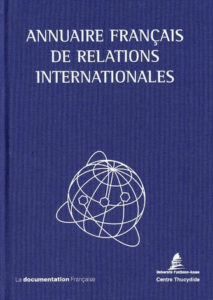
La création d'une Assemblée parlementaire franco-allemande trouve son origine dans le discours du président français Emmanuel Macron "pour une Europe souveraine, unie, démocratique", prononcé à la Sorbonne le 26 septembre 2017, dans lequel le président français a souligné qu'il ne pourrait y avoir de progrès durable de la construction européenne sans un approfondissement du partenariat franco-allemand sur la base d'un "nouveau traité de coopération" dans le prolongement du traité de l'Élysée de janvier 1963. Une résolution commune de l'Assemblée nationale et du Bundestag en faveur de l'élaboration d'un nouveau traité de l'Élysée a été examinée. Le projet d'accord sur la coopération parlementaire franco-allemande a été établi le 8 octobre 2018 après consultation du Bureau de l'Assemblée nationale et du Präsidium du Bundestag réunis à Lübeck le 20 novembre 2018. Cet accord prévoit une intensification des relations entre l'Assemblée nationale et le Bundestag (réunions communes des assemblées, de leurs bureaux et de leurs commissions, notamment), mais surtout il instaure dans son chapitre premier une Assemblée parlementaire franco-allemande (APFA) composée de cinquante membres de l'Assemblée nationale et de cinquante membres du Bundestag respectivement élus au début de chacune de leurs législatures selon leurs règles internes. Les attributions de l'APFA sont : veiller à l'application du traité d'Aix-la-Chapelle et à la mise en oeuvre des projets qui en découlent, suivre les conseils des ministres franco-allemands, suivre les activités du Conseil franco-allemand de défense et de sécurité, assurer le suivi des affaires internationales et européennes présentant un intérêt commun, formuler des propositions sur toute question intéressant les relations franco-allemandes en vue de tendre à une convergence des droits français et allemand.
Lien de la contribution:
https://www.afri-ct.org/article/lassemblee-parlementaire-franco-allemande-une-nouvelle-dimension-du-partenariat-franco-allemand/Août 31, 2021
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | PACREAU, XAVIER; STARK, HANS |
|---|
| Source / Fundstelle: | Centre Thycidide, Éditions Panthéon-Assas |
|---|
| Revue / Zeitschrift: | Annuaire français de relations internationales , vol. XXI, pp.351-365 |
|---|
| Année / Jahr: | 2020 |
|---|
| Localisation / Standort: | Annuaire français de relations internationales |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Droit international public, droit politique, Politiques, économie et société |
|---|
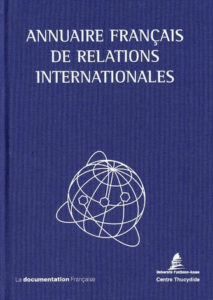
Le 22 janvier 2019 la République fédérale d'Allemagne et la France signent le traité d'Aix-la-Chapelle qui révèle la volonté des deux États limitrophes de s'engager l'un envers l'autre dans le cadre d'une relation franco-allemande afin de développer la coopération, la concertation et le dialogue entre les deux États. Il s'agit de répondre à un certain essoufflement des relations franco-allemandes. Le traité d'Aix-la-Chapelle doit être associé à l'accord conclu entre l'Assemblée nationale et le Bundestag le 11 mars 2019 et destiné à mettre en place une Assemblée parlementaire franco-allemande ayant pour fonction de suivre sa mise en oeuvre. Le traité de 2019 aborde des champs de coopération plus vastes que le traité franco-allemand de 1963 et s'inscrit dans une perspective de long terme. Ce projet ambitieux est soumis à une évaluation permanente par les élus français et allemands. La nature que nouent la France et l'Allemagne aujourd'hui a une évidente force de symbole et de modèle - ce qui rend le "couple" franco-allemand plus indispensable que jamais.
La contribution se penche sur la question du développement de la relation bilatérale et de la construction européenne en matière de politique étrangère et de défense pour ensuite s'interroger sur l'intégration des économies françaises et allemandes.
Lien de la contribution:
https://www.afri-ct.org/article/le-traite-sur-la-cooperation-et-lintegration-franco-allemande-daix-la-chapelle/Juin 21, 2021
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | HOCHMANN, THOMAS |
|---|
| Source / Fundstelle: | AJDA, n°14 2021, p. 805 - 809 |
|---|
| Revue / Zeitschrift: | Actualité Juridique Droit Administratif français |
|---|
| Année / Jahr: | 2021 |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Droit comparé, Droit constitutionnel |
|---|
| Mots clef / Schlagworte: | Contrôle de Proportionnalité |
|---|
 Résumé de l'auteur:
Résumé de l'auteur:
La formalisation allemande du principe de proportionnalité est indubitablement l'un des succès d'exportation de nos voisins d'outre-Rhin. Toutefois, la version mondialisée est souvent simplifiée par rapport à l'analyse à laquelle se livre la Cour constitutionnelle allemande, qui commence par vérifier la conformité à la Loi fondamentale du but poursuivi. L'ordre d'examen des questions par le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État en France est d'ailleurs souvent bien différent de celui du juge allemand.
Juin 9, 2021

La justice numérique vise à améliorer l'accès à la justice et constitue un élément essentiel du fonctionnement de celle-ci. En octobre 2020, le Conseil de l'Union européenne a appelé à saisir les possibilités offertes par la numérisation pour améliorer l'accès à la justice. En tant que mode d'exécution des tâches juridictionnelles, l'E-Justiz soulève avant tout le défi de sa mise en oeuvre technique et organisationnelle définie par la loi et incombant aux Länder. Le cadre législatif n'efface pas les disparités entre les différentes juridictions et leurs missions, mais aussi les différences entre les Etats fédérés. La numérisation de la justice recouvre ainsi plusieurs problématiques: le recours aux technologies de l'information pour faire face aux "tâches bureaucratiques" de la justice, la numérisation et la communication avec le public, l'obtention et la préparation des données juridiques. Le rôle de l'intelligence artificielle constitue également un point de réflexion car en vertu de l'article 97 de la Loi fondamentale le pouvoir judiciaire est confié aux juges qui sont des personnes physiques. L'utilisation d'algorithmes ne peut par conséquent remplacer les juges dans l'accomplissement de cette mission. La numérisation peut soulever des interrogations relatives à la maîtrise des données et au contrôle de l'activité judiciaire.
Finalement, il s'agit d'un processus de développement organisationnel dont la forme et la vitesse d'évolution doivent être maîtrisées. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un domaine sensible de l'Etat de droit et que la numérisation n'est pas dépourvue de tout risque pour la justice.
Mar 14, 2021
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | CLASSEN, CLAUS DIETER |
|---|
| Source / Fundstelle: | Éditions Panthéon-Assas |
|---|
| Année / Jahr: | 2021 |
|---|
| Localisation / Standort: | in Gilles J. Gugliemi (dir.), Les mutations de la liberté d'expression en droit français et étranger, pp.87-100 |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Droit constitutionnel, Procédure constitutionnelle |
|---|

Si en Allemagne comme ailleurs, les règles du droit ordinaire régissant la portée de la liberté d’opinion dans les relations entre personnes privées sont fortement imprégnées par le droit constitutionnel, il y a une spécificité en ce qui concerne le droit à la réputation et à l’honneur. Dans ce domaine, l’envahissement du droit public dans le droit privé a eu lieu sur invitation des tribunaux ordinaires. En outre, cet envahissement ne se limite pas au droit matériel, laissant son application aux tribunaux ordinaires comme c’est le cas en France. Grâce au recours constitutionnel individuel, la Cour constitutionnelle fédérale allemande a le dernier mot même en ce qui concerne l’application des règles constitutionnelles dans des cas concrets – ce qui, de toute évidence, soulève la question de la répartition des compétences entre Cour constitutionnelle et tribunaux ordinaires. Longtemps, le droit à la réputation et à l’honneur n’a joué pratiquement aucun rôle en droit civil allemand. C’est d’ailleurs la raison principale de l’évolution entreprise par Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof), c’est-à-dire la Cour suprême en matières civiles et pénales. Cette évolution date de 1954, peu après l’entrée en vigueur de la Loi fondamentale (23 mai 1949). La Cour fédérale de justice a alors choisi de se référer au droit constitutionnel pour développer un droit à la réputation et à l’honneur, qualifié, de manière générique, de droit de la personnalité. Elle a proposé cette évolution avant même que la Cour constitutionnelle ne se penche elle-même sur la détermination épineuse du rôle du droit constitutionnel dans les relations entre personnes privées (I.). Le droit à l’honneur, composante du droit général de la personnalité garanti par la combinaison de l’art. 1 al. 1 et l’art. 2 al. 1 LF, peut, à l’heure actuelle, être invoqué à la fois devant les tribunaux ordinaires et devant la Cour constitutionnelle fédérale. Pour cette raison, avant de traiter le droit matériel, il faut d’abord parler un peu de la répartition des compétences entre les tribunaux ordinaires et la Cour constitutionnelle fédérale (II.).

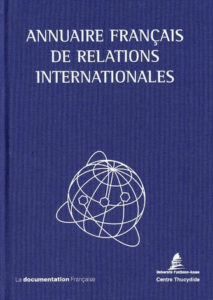 La création d'une Assemblée parlementaire franco-allemande trouve son origine dans le discours du président français Emmanuel Macron "pour une Europe souveraine, unie, démocratique", prononcé à la Sorbonne le 26 septembre 2017, dans lequel le président français a souligné qu'il ne pourrait y avoir de progrès durable de la construction européenne sans un approfondissement du partenariat franco-allemand sur la base d'un "nouveau traité de coopération" dans le prolongement du traité de l'Élysée de janvier 1963. Une résolution commune de l'Assemblée nationale et du Bundestag en faveur de l'élaboration d'un nouveau traité de l'Élysée a été examinée. Le projet d'accord sur la coopération parlementaire franco-allemande a été établi le 8 octobre 2018 après consultation du Bureau de l'Assemblée nationale et du Präsidium du Bundestag réunis à Lübeck le 20 novembre 2018. Cet accord prévoit une intensification des relations entre l'Assemblée nationale et le Bundestag (réunions communes des assemblées, de leurs bureaux et de leurs commissions, notamment), mais surtout il instaure dans son chapitre premier une Assemblée parlementaire franco-allemande (APFA) composée de cinquante membres de l'Assemblée nationale et de cinquante membres du Bundestag respectivement élus au début de chacune de leurs législatures selon leurs règles internes. Les attributions de l'APFA sont : veiller à l'application du traité d'Aix-la-Chapelle et à la mise en oeuvre des projets qui en découlent, suivre les conseils des ministres franco-allemands, suivre les activités du Conseil franco-allemand de défense et de sécurité, assurer le suivi des affaires internationales et européennes présentant un intérêt commun, formuler des propositions sur toute question intéressant les relations franco-allemandes en vue de tendre à une convergence des droits français et allemand.
Lien de la contribution: https://www.afri-ct.org/article/lassemblee-parlementaire-franco-allemande-une-nouvelle-dimension-du-partenariat-franco-allemand/
La création d'une Assemblée parlementaire franco-allemande trouve son origine dans le discours du président français Emmanuel Macron "pour une Europe souveraine, unie, démocratique", prononcé à la Sorbonne le 26 septembre 2017, dans lequel le président français a souligné qu'il ne pourrait y avoir de progrès durable de la construction européenne sans un approfondissement du partenariat franco-allemand sur la base d'un "nouveau traité de coopération" dans le prolongement du traité de l'Élysée de janvier 1963. Une résolution commune de l'Assemblée nationale et du Bundestag en faveur de l'élaboration d'un nouveau traité de l'Élysée a été examinée. Le projet d'accord sur la coopération parlementaire franco-allemande a été établi le 8 octobre 2018 après consultation du Bureau de l'Assemblée nationale et du Präsidium du Bundestag réunis à Lübeck le 20 novembre 2018. Cet accord prévoit une intensification des relations entre l'Assemblée nationale et le Bundestag (réunions communes des assemblées, de leurs bureaux et de leurs commissions, notamment), mais surtout il instaure dans son chapitre premier une Assemblée parlementaire franco-allemande (APFA) composée de cinquante membres de l'Assemblée nationale et de cinquante membres du Bundestag respectivement élus au début de chacune de leurs législatures selon leurs règles internes. Les attributions de l'APFA sont : veiller à l'application du traité d'Aix-la-Chapelle et à la mise en oeuvre des projets qui en découlent, suivre les conseils des ministres franco-allemands, suivre les activités du Conseil franco-allemand de défense et de sécurité, assurer le suivi des affaires internationales et européennes présentant un intérêt commun, formuler des propositions sur toute question intéressant les relations franco-allemandes en vue de tendre à une convergence des droits français et allemand.
Lien de la contribution: https://www.afri-ct.org/article/lassemblee-parlementaire-franco-allemande-une-nouvelle-dimension-du-partenariat-franco-allemand/



