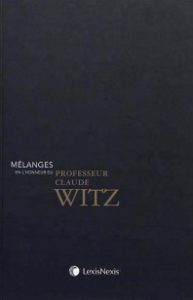Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | GROSS, NORBERT |
|---|
| Source / Fundstelle: | in La cassation: genèse, évolution, méthode et diffusion d'une technique singulière, Dalloz, p. 161-170 |
|---|
| Année / Jahr: | 2023 |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Droit privé, Histoire du droit, pratique du droit, Procédure civile |
|---|
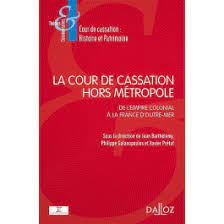
La contribution de Norbert Gross, ancien président de l’Ordre des avocats au
Bundesgerichtshof, dans l’ouvrage collectif, paru en langue française, analyse avec finesse les origines de la procédure allemande la cassation, tout en mettant en exergue les différences insurmontables entre les modèles français et allemand, ainsi que les similitudes trompeuses des termes «
Revision » et « cassation ».
La Cour de justice fédérale (
Bundesgerichtshof) allemande commence son histoire le 8 octobre 1950, même si elle n’est pas une innovation du système juridique de la jeune République fédérale. Il est possible de tracer sa filiation en remontant jusqu’à la Cour du Saint Empire germanique (
Reichskammergericht), fondée à Francfort en 1495, qui, après un passage à Spire (1527), s’est durablement établie à Wetzlar (1690). Le Code de procédure de 1495-1555 et la pratique de la Cour de l’Empire sont à l’origine d’une véritable procédure de cassation mêlant à l’époque recours en appel, pourvoi en «
Revision » et pourvoi en nullité.
Ce modèle « allemand » est rompu entre 1815 et 1879. Quatre cours de cassation se trouvent installées (en Rhénanie, au Palatinat, en Hesse Rhénane et à Leipzig), qui ont pour modèle la Cour de cassation de Paris et qui emploient à la lettre le Code de procédure civile français. Cette période prend fin avec la création d’une Cour de l’Empire (
Reichsgericht) à Leipzig et l’entrée en vigueur d’un nouveau Code de procédure civile (
Zivilprozessordnung). Le modèle français est alors perçu comme trop formaliste, rigide et proche de l’État. Le
Reichsgericht devient ainsi un
Revisionsgericht, une « cour de révision ». Cette transformation marque consomme la séparation définitive d’avec la tradition française procédurale. En revanche, le Code civil continue à exercer une influence : la deuxième chambre civile de la Cour de l’Empire, appelée « la Rhénane » ou « la Française » applique les règles du Code civil napoléonien jusqu’à l’entrée en vigueur du
Bundesgesetzbuch en 1900, plus adapté à l’esprit allemand et toujours en vigueur. C’est le
Reichsgericht qui donne ses contours à la Cour de justice fédérale.
L’activité du
Bundesgerichtshof se limite à la justice judiciaire (civile et pénale), les autres matières comme le droit du travail, les affaires sociales et le contentieux administratif sont attribuées à des cours fédérales spécialisées. La Cour de justice fédérale est une « cour de révision » et le recours – « pourvoi en révision », qui n’est pas semblable au recours en révision de l’article 593 du Code de procédure civile français. La Cour allemande peut casser une décision de cour d’appel, mais peut aussi aller plus loin : si les faits souverainement constatés par les juges du fond le permettent, elle peut prendre une décision au fond sans qu’un renvoi soit nécessaire. En cas de cassation, l’affaire est renvoyée à la même cour d’appel obligée de suivre l’interprétation donnée par la Cour de justice fédérale. L’instance de cassation est confiée aux seules mains des parties, maîtres de la procédure. Le rôle d’un avocat général ou d’un autre organe agissant dans l’intérêt de la loi est inconnu. La cassation (
Revision) ne constitue pas une voie de recours extraordinaire, mais comme le troisième niveau de la procédure juridictionnelle.
Trois critères spécifiques ouvrent la voie de la cassation : si l’affaire soulève une question de principe (1), si l’affaire présente un intérêt pour le développement du droit (2) ou si l’affaire présente un besoin pour l’unification du droit notamment en cas de divergence de jurisprudence (3). La simple violation de la loi ne constitue pas une cause d’accès à la cassation. Ces critères ont été assouplis par la jurisprudence de la Cour : ainsi, toute violation des droits fondamentaux permet d’ouvrir l’instance de cassation. L’accès à la cassation repose sur une procédure d’admission à deux niveaux. L’admission d’un pourvoi en cassation peut être accordée soit par la décision expresse de la cour d’appel dans l’arrêt attaqué, soit après une procédure d’admission préalable par une chambre civile du
Bundesgerichtshof lui-même. Si la cour d’appel a refusé l’admission ou en cas de silence de l’arrêt, un pourvoi peut être directement introduit auprès du
Bundesgerichtshof qui se prononce sur une éventuelle admission. Dans cette dernière hypothèse, la valeur du litige doit être égale ou supérieure à 20 000 euros. Pour les valeurs inférieures, la seule voie d’accès est l’admission par la cour d’appel.
Comme le note à juste titre Norbert Gross, « le droit de la procédure et notamment celui de la cassation est aujourd’hui, comme hier et demain, un éternel terrain d’essais, ouvert au monde et à la recherche de solution à la fois cohérentes et pragmatiques ». Le « laboratoire franco-allemand » a conduit, au fil des années, au rapprochement de la « cassation » française et la «
Revision » allemande, mais les différences profondes résultant de l’histoire et de la culture juridique de ces deux pays restent plus perceptibles que jamais.

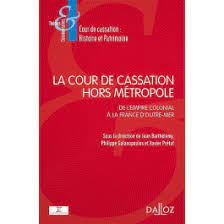 La contribution de Norbert Gross, ancien président de l’Ordre des avocats au Bundesgerichtshof, dans l’ouvrage collectif, paru en langue française, analyse avec finesse les origines de la procédure allemande la cassation, tout en mettant en exergue les différences insurmontables entre les modèles français et allemand, ainsi que les similitudes trompeuses des termes « Revision » et « cassation ».
La Cour de justice fédérale (Bundesgerichtshof) allemande commence son histoire le 8 octobre 1950, même si elle n’est pas une innovation du système juridique de la jeune République fédérale. Il est possible de tracer sa filiation en remontant jusqu’à la Cour du Saint Empire germanique (Reichskammergericht), fondée à Francfort en 1495, qui, après un passage à Spire (1527), s’est durablement établie à Wetzlar (1690). Le Code de procédure de 1495-1555 et la pratique de la Cour de l’Empire sont à l’origine d’une véritable procédure de cassation mêlant à l’époque recours en appel, pourvoi en « Revision » et pourvoi en nullité.
Ce modèle « allemand » est rompu entre 1815 et 1879. Quatre cours de cassation se trouvent installées (en Rhénanie, au Palatinat, en Hesse Rhénane et à Leipzig), qui ont pour modèle la Cour de cassation de Paris et qui emploient à la lettre le Code de procédure civile français. Cette période prend fin avec la création d’une Cour de l’Empire (Reichsgericht) à Leipzig et l’entrée en vigueur d’un nouveau Code de procédure civile (Zivilprozessordnung). Le modèle français est alors perçu comme trop formaliste, rigide et proche de l’État. Le Reichsgericht devient ainsi un Revisionsgericht, une « cour de révision ». Cette transformation marque consomme la séparation définitive d’avec la tradition française procédurale. En revanche, le Code civil continue à exercer une influence : la deuxième chambre civile de la Cour de l’Empire, appelée « la Rhénane » ou « la Française » applique les règles du Code civil napoléonien jusqu’à l’entrée en vigueur du Bundesgesetzbuch en 1900, plus adapté à l’esprit allemand et toujours en vigueur. C’est le Reichsgericht qui donne ses contours à la Cour de justice fédérale.
L’activité du Bundesgerichtshof se limite à la justice judiciaire (civile et pénale), les autres matières comme le droit du travail, les affaires sociales et le contentieux administratif sont attribuées à des cours fédérales spécialisées. La Cour de justice fédérale est une « cour de révision » et le recours – « pourvoi en révision », qui n’est pas semblable au recours en révision de l’article 593 du Code de procédure civile français. La Cour allemande peut casser une décision de cour d’appel, mais peut aussi aller plus loin : si les faits souverainement constatés par les juges du fond le permettent, elle peut prendre une décision au fond sans qu’un renvoi soit nécessaire. En cas de cassation, l’affaire est renvoyée à la même cour d’appel obligée de suivre l’interprétation donnée par la Cour de justice fédérale. L’instance de cassation est confiée aux seules mains des parties, maîtres de la procédure. Le rôle d’un avocat général ou d’un autre organe agissant dans l’intérêt de la loi est inconnu. La cassation (Revision) ne constitue pas une voie de recours extraordinaire, mais comme le troisième niveau de la procédure juridictionnelle.
Trois critères spécifiques ouvrent la voie de la cassation : si l’affaire soulève une question de principe (1), si l’affaire présente un intérêt pour le développement du droit (2) ou si l’affaire présente un besoin pour l’unification du droit notamment en cas de divergence de jurisprudence (3). La simple violation de la loi ne constitue pas une cause d’accès à la cassation. Ces critères ont été assouplis par la jurisprudence de la Cour : ainsi, toute violation des droits fondamentaux permet d’ouvrir l’instance de cassation. L’accès à la cassation repose sur une procédure d’admission à deux niveaux. L’admission d’un pourvoi en cassation peut être accordée soit par la décision expresse de la cour d’appel dans l’arrêt attaqué, soit après une procédure d’admission préalable par une chambre civile du Bundesgerichtshof lui-même. Si la cour d’appel a refusé l’admission ou en cas de silence de l’arrêt, un pourvoi peut être directement introduit auprès du Bundesgerichtshof qui se prononce sur une éventuelle admission. Dans cette dernière hypothèse, la valeur du litige doit être égale ou supérieure à 20 000 euros. Pour les valeurs inférieures, la seule voie d’accès est l’admission par la cour d’appel.
Comme le note à juste titre Norbert Gross, « le droit de la procédure et notamment celui de la cassation est aujourd’hui, comme hier et demain, un éternel terrain d’essais, ouvert au monde et à la recherche de solution à la fois cohérentes et pragmatiques ». Le « laboratoire franco-allemand » a conduit, au fil des années, au rapprochement de la « cassation » française et la « Revision » allemande, mais les différences profondes résultant de l’histoire et de la culture juridique de ces deux pays restent plus perceptibles que jamais.
La contribution de Norbert Gross, ancien président de l’Ordre des avocats au Bundesgerichtshof, dans l’ouvrage collectif, paru en langue française, analyse avec finesse les origines de la procédure allemande la cassation, tout en mettant en exergue les différences insurmontables entre les modèles français et allemand, ainsi que les similitudes trompeuses des termes « Revision » et « cassation ».
La Cour de justice fédérale (Bundesgerichtshof) allemande commence son histoire le 8 octobre 1950, même si elle n’est pas une innovation du système juridique de la jeune République fédérale. Il est possible de tracer sa filiation en remontant jusqu’à la Cour du Saint Empire germanique (Reichskammergericht), fondée à Francfort en 1495, qui, après un passage à Spire (1527), s’est durablement établie à Wetzlar (1690). Le Code de procédure de 1495-1555 et la pratique de la Cour de l’Empire sont à l’origine d’une véritable procédure de cassation mêlant à l’époque recours en appel, pourvoi en « Revision » et pourvoi en nullité.
Ce modèle « allemand » est rompu entre 1815 et 1879. Quatre cours de cassation se trouvent installées (en Rhénanie, au Palatinat, en Hesse Rhénane et à Leipzig), qui ont pour modèle la Cour de cassation de Paris et qui emploient à la lettre le Code de procédure civile français. Cette période prend fin avec la création d’une Cour de l’Empire (Reichsgericht) à Leipzig et l’entrée en vigueur d’un nouveau Code de procédure civile (Zivilprozessordnung). Le modèle français est alors perçu comme trop formaliste, rigide et proche de l’État. Le Reichsgericht devient ainsi un Revisionsgericht, une « cour de révision ». Cette transformation marque consomme la séparation définitive d’avec la tradition française procédurale. En revanche, le Code civil continue à exercer une influence : la deuxième chambre civile de la Cour de l’Empire, appelée « la Rhénane » ou « la Française » applique les règles du Code civil napoléonien jusqu’à l’entrée en vigueur du Bundesgesetzbuch en 1900, plus adapté à l’esprit allemand et toujours en vigueur. C’est le Reichsgericht qui donne ses contours à la Cour de justice fédérale.
L’activité du Bundesgerichtshof se limite à la justice judiciaire (civile et pénale), les autres matières comme le droit du travail, les affaires sociales et le contentieux administratif sont attribuées à des cours fédérales spécialisées. La Cour de justice fédérale est une « cour de révision » et le recours – « pourvoi en révision », qui n’est pas semblable au recours en révision de l’article 593 du Code de procédure civile français. La Cour allemande peut casser une décision de cour d’appel, mais peut aussi aller plus loin : si les faits souverainement constatés par les juges du fond le permettent, elle peut prendre une décision au fond sans qu’un renvoi soit nécessaire. En cas de cassation, l’affaire est renvoyée à la même cour d’appel obligée de suivre l’interprétation donnée par la Cour de justice fédérale. L’instance de cassation est confiée aux seules mains des parties, maîtres de la procédure. Le rôle d’un avocat général ou d’un autre organe agissant dans l’intérêt de la loi est inconnu. La cassation (Revision) ne constitue pas une voie de recours extraordinaire, mais comme le troisième niveau de la procédure juridictionnelle.
Trois critères spécifiques ouvrent la voie de la cassation : si l’affaire soulève une question de principe (1), si l’affaire présente un intérêt pour le développement du droit (2) ou si l’affaire présente un besoin pour l’unification du droit notamment en cas de divergence de jurisprudence (3). La simple violation de la loi ne constitue pas une cause d’accès à la cassation. Ces critères ont été assouplis par la jurisprudence de la Cour : ainsi, toute violation des droits fondamentaux permet d’ouvrir l’instance de cassation. L’accès à la cassation repose sur une procédure d’admission à deux niveaux. L’admission d’un pourvoi en cassation peut être accordée soit par la décision expresse de la cour d’appel dans l’arrêt attaqué, soit après une procédure d’admission préalable par une chambre civile du Bundesgerichtshof lui-même. Si la cour d’appel a refusé l’admission ou en cas de silence de l’arrêt, un pourvoi peut être directement introduit auprès du Bundesgerichtshof qui se prononce sur une éventuelle admission. Dans cette dernière hypothèse, la valeur du litige doit être égale ou supérieure à 20 000 euros. Pour les valeurs inférieures, la seule voie d’accès est l’admission par la cour d’appel.
Comme le note à juste titre Norbert Gross, « le droit de la procédure et notamment celui de la cassation est aujourd’hui, comme hier et demain, un éternel terrain d’essais, ouvert au monde et à la recherche de solution à la fois cohérentes et pragmatiques ». Le « laboratoire franco-allemand » a conduit, au fil des années, au rapprochement de la « cassation » française et la « Revision » allemande, mais les différences profondes résultant de l’histoire et de la culture juridique de ces deux pays restent plus perceptibles que jamais.