Août 23, 2024
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | GAILLET, AURORE; JESTAEDT, MATTHIAS |
|---|
| Source / Fundstelle: | La doctrine et le Conseil constitutionnel, Editions Dalloz, Paris 2024, p. 313–338 |
|---|
| Année / Jahr: | 2024 |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Droit constitutionnel, Droit public, Staatsrecht, Verfassungsrecht |
|---|
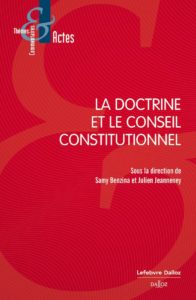
La contribution a été publiée dans l'ouvrage « La doctrine et le Conseil constitutionnel » dirigé par Julien Jeanneney et Samy Benzina, qui porte sur l'évolution des relations du Conseil constitutionnel français avec la doctrine en France. Les liens qui ont uni les professeurs de droit au sein du Conseil constitutionnel y sont étudiés.
Dans une perspective franco-allemande, la contribution analyse le rapport de la Cour fédérale allemande avec la doctrine allemande. En effet, la situation allemande offre le contraste d’une justice constitutionnelle structurellement et institutionnellement différente, et entretenant un dialogue constant et approfondi avec la doctrine. L'article examine ainsi les facteurs ayant influencé la communication étroite entre doctrine – au sens de science juridique – et pratique du droit – notamment telle qu’interprétée par la jurisprudence.
Dans une première partie, les auteurs contextualisent l'évolution historique de la relation entre la doctrine et la Cour constitutionnelle. Dans une seconde partie, l'importance de la « dogmatique » est étudiée, qui constitue un langage commun entre la Cour et la doctrine constitutionnelle. Bien que cela entraîne un enrichissement mutuel, il en découle également, de manière inévitable, pour la science du droit constitutionnel, un risque de « positivisme de la jurisprudence constitutionnelle ». Enfin, dans une troisième partie, les auteurs examinent comment il appartient à la doctrine de préciser en permanence sa position et son identité pour répondre à ces critiques.
Déc 19, 2021

La Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne est devenue l’une des institutions les plus influentes en Europe, voire dans le monde. Pour comprendre la construction de cette institution née des cendres de l’Allemagne d’après-guerre, il faut remonter aux origines de sa création, à la volonté d’associer l’ancienne tradition de limitation du pouvoir par le droit et la réédification démocratique de l’Allemagne. C’est cette histoire que nous raconte Aurore Gaillet, en abordant les aspects juridique, politique et intellectuel du
Bundesverfassungsgericht en rendant accessible pour le public français non-germanophone les étapes importantes de la construction de cette institution.
Prévue par la Loi fondamentale de 1949 et installée à Karlsruhe en 1951, la Cour constitutionnelle fédérale allemande est devenue l’incontournable acteur du paysage juridictionnel européen. Il faut observer, à côté de la construction institutionnelle, la manière dont la Cour s’est-elle-même inscrite dans un processus dynamique d’affirmation de son autorité. Grâce à la connaissance de l’histoire et de l’univers juridique allemands, l’auteur livre un texte qui facilitera sans conteste la compréhension de la culture juridique allemande et permettra une réflexion globale sur la justice constitutionnelle.
Juin 21, 2021
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | HOCHMANN, THOMAS |
|---|
| Source / Fundstelle: | AJDA, n°14 2021, p. 805 - 809 |
|---|
| Revue / Zeitschrift: | Actualité Juridique Droit Administratif français |
|---|
| Année / Jahr: | 2021 |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Droit comparé, Droit constitutionnel |
|---|
| Mots clef / Schlagworte: | Contrôle de Proportionnalité |
|---|
 Résumé de l'auteur:
Résumé de l'auteur:
La formalisation allemande du principe de proportionnalité est indubitablement l'un des succès d'exportation de nos voisins d'outre-Rhin. Toutefois, la version mondialisée est souvent simplifiée par rapport à l'analyse à laquelle se livre la Cour constitutionnelle allemande, qui commence par vérifier la conformité à la Loi fondamentale du but poursuivi. L'ordre d'examen des questions par le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État en France est d'ailleurs souvent bien différent de celui du juge allemand.
Mar 14, 2021
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | CLASSEN, CLAUS DIETER |
|---|
| Source / Fundstelle: | Éditions Panthéon-Assas |
|---|
| Année / Jahr: | 2021 |
|---|
| Localisation / Standort: | in Gilles J. Gugliemi (dir.), Les mutations de la liberté d'expression en droit français et étranger, pp.87-100 |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Droit constitutionnel, Procédure constitutionnelle |
|---|

Si en Allemagne comme ailleurs, les règles du droit ordinaire régissant la portée de la liberté d’opinion dans les relations entre personnes privées sont fortement imprégnées par le droit constitutionnel, il y a une spécificité en ce qui concerne le droit à la réputation et à l’honneur. Dans ce domaine, l’envahissement du droit public dans le droit privé a eu lieu sur invitation des tribunaux ordinaires. En outre, cet envahissement ne se limite pas au droit matériel, laissant son application aux tribunaux ordinaires comme c’est le cas en France. Grâce au recours constitutionnel individuel, la Cour constitutionnelle fédérale allemande a le dernier mot même en ce qui concerne l’application des règles constitutionnelles dans des cas concrets – ce qui, de toute évidence, soulève la question de la répartition des compétences entre Cour constitutionnelle et tribunaux ordinaires. Longtemps, le droit à la réputation et à l’honneur n’a joué pratiquement aucun rôle en droit civil allemand. C’est d’ailleurs la raison principale de l’évolution entreprise par Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof), c’est-à-dire la Cour suprême en matières civiles et pénales. Cette évolution date de 1954, peu après l’entrée en vigueur de la Loi fondamentale (23 mai 1949). La Cour fédérale de justice a alors choisi de se référer au droit constitutionnel pour développer un droit à la réputation et à l’honneur, qualifié, de manière générique, de droit de la personnalité. Elle a proposé cette évolution avant même que la Cour constitutionnelle ne se penche elle-même sur la détermination épineuse du rôle du droit constitutionnel dans les relations entre personnes privées (I.). Le droit à l’honneur, composante du droit général de la personnalité garanti par la combinaison de l’art. 1 al. 1 et l’art. 2 al. 1 LF, peut, à l’heure actuelle, être invoqué à la fois devant les tribunaux ordinaires et devant la Cour constitutionnelle fédérale. Pour cette raison, avant de traiter le droit matériel, il faut d’abord parler un peu de la répartition des compétences entre les tribunaux ordinaires et la Cour constitutionnelle fédérale (II.).
Mar 14, 2021
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | GAILLET, AURORE |
|---|
| Source / Fundstelle: | Éditions Panthéon-Assas |
|---|
| Année / Jahr: | 2021 |
|---|
| Localisation / Standort: | in Gilles J. Gugliemi, Les mutations de la liberté d'expression en droit français et étranger, pp. 26-42 |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Droit constitutionnel, Procédure constitutionnelle |
|---|

Les faits de l’affaire Lüth rendu par la Cour constitutionnelle fédérale le 15 janvier 1958 soulignent tant l’importance du « désir collectif de refoulement » – et l’aspiration concomitante à la « normalisation » de la vie quotidienne – que la marque indélébile du national-socialisme pour l’histoire allemande. À l’origine de l’affaire se trouve un appel au boycott lancé par Erich Lüth, à l’occasion de l’ouverture de la «semaine du film allemand » (Woche des deutschen Films) le 21 septembre 1950. Le directeur du service de presse de la ville de Hambourg manifeste ce faisant, à titre individuel cependant, son indignation face au choix de présenter en avant-première le nouveau film du régisseur Veit Harlan (Unsterbliche Geliebte – L’amante immortelle), en dépit de la triste notoriété de son auteur, associé à son film de propagande antisémite Le juif Süss (1940). Contesté en justice par les sociétés de production cinématographique concernées, l’appel au boycott est jugé «contraire aux bonnes mœurs», sur le fondement du § 826 du Code civil allemand (BGB). Lüth se voit imposer d’y mettre fin. Sa défense, fondée sur le « droit d’exprimer et de diffuser librement son opinion », garanti par l’article 5 al. 1 de a Loi fondamentale allemande, est écartée, les droits fondamentaux ne valant classiquement pas pour les rapports entre personnes privées. La formation d’un recours constitutionnel individuel contre le jugement du tribunal civil de Hambourg permettra précisément à la Cour constitutionnelle fédérale de revenir sur cette interprétation. Sept ans après la formation du recours, la Première chambre de la Cour (Erster Senat) reconnaît le caractère fondé du recours et ouvre la porte à « l’innovation la plus spectaculaire du droit public allemand après 1945». L’arrêt Lüth peut ainsi être analysé comme un « tournant historique » dans au moins deux directions. Il faut d’abord comprendre comment, en posant une théorie des droits fondamentaux à partir de la liberté d’expression (I), la Cour constitutionnelle fédérale a établi les bases d’une évolution décisive pour le système juridique et juridictionnel allemand (II). L’accent mis sur les éléments quelque peu dépassés ou datés de la décision engagera ensuite à présenter quelques pistes d’actualisation de la «dogmatique» issue de la jurisprudence Lüth (III).

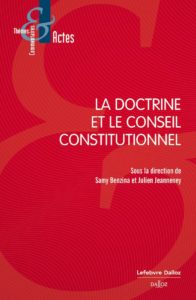 La contribution a été publiée dans l'ouvrage « La doctrine et le Conseil constitutionnel » dirigé par Julien Jeanneney et Samy Benzina, qui porte sur l'évolution des relations du Conseil constitutionnel français avec la doctrine en France. Les liens qui ont uni les professeurs de droit au sein du Conseil constitutionnel y sont étudiés.
Dans une perspective franco-allemande, la contribution analyse le rapport de la Cour fédérale allemande avec la doctrine allemande. En effet, la situation allemande offre le contraste d’une justice constitutionnelle structurellement et institutionnellement différente, et entretenant un dialogue constant et approfondi avec la doctrine. L'article examine ainsi les facteurs ayant influencé la communication étroite entre doctrine – au sens de science juridique – et pratique du droit – notamment telle qu’interprétée par la jurisprudence.
Dans une première partie, les auteurs contextualisent l'évolution historique de la relation entre la doctrine et la Cour constitutionnelle. Dans une seconde partie, l'importance de la « dogmatique » est étudiée, qui constitue un langage commun entre la Cour et la doctrine constitutionnelle. Bien que cela entraîne un enrichissement mutuel, il en découle également, de manière inévitable, pour la science du droit constitutionnel, un risque de « positivisme de la jurisprudence constitutionnelle ». Enfin, dans une troisième partie, les auteurs examinent comment il appartient à la doctrine de préciser en permanence sa position et son identité pour répondre à ces critiques.
La contribution a été publiée dans l'ouvrage « La doctrine et le Conseil constitutionnel » dirigé par Julien Jeanneney et Samy Benzina, qui porte sur l'évolution des relations du Conseil constitutionnel français avec la doctrine en France. Les liens qui ont uni les professeurs de droit au sein du Conseil constitutionnel y sont étudiés.
Dans une perspective franco-allemande, la contribution analyse le rapport de la Cour fédérale allemande avec la doctrine allemande. En effet, la situation allemande offre le contraste d’une justice constitutionnelle structurellement et institutionnellement différente, et entretenant un dialogue constant et approfondi avec la doctrine. L'article examine ainsi les facteurs ayant influencé la communication étroite entre doctrine – au sens de science juridique – et pratique du droit – notamment telle qu’interprétée par la jurisprudence.
Dans une première partie, les auteurs contextualisent l'évolution historique de la relation entre la doctrine et la Cour constitutionnelle. Dans une seconde partie, l'importance de la « dogmatique » est étudiée, qui constitue un langage commun entre la Cour et la doctrine constitutionnelle. Bien que cela entraîne un enrichissement mutuel, il en découle également, de manière inévitable, pour la science du droit constitutionnel, un risque de « positivisme de la jurisprudence constitutionnelle ». Enfin, dans une troisième partie, les auteurs examinent comment il appartient à la doctrine de préciser en permanence sa position et son identité pour répondre à ces critiques.



