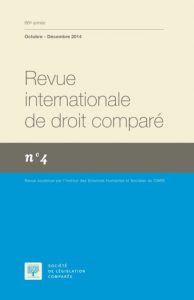Oct 18, 2011
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | VOGEL LOUIS |
|---|
| Source / Fundstelle: | Éditions Panthéon-Assas, coll. Droit global |
|---|
| Année / Jahr: | 2011 |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Droit comparé, Droit de la concurrence |
|---|
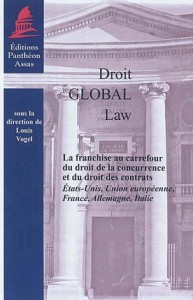
4e de couverture: Particulièrement adapté à la franchise, le droit comparé démontre, au-delà de conceptions nationales différentes, le rôle économique unique de cet instrument juridique. L'examen des droits américain, européen, français, allemand et italien révèle qu'ils se concentrent encore trop souvent sur la définition des obligations réciproques des parties sans tenir suffisamment compte du réseau dans lequel le contrat s'insère. Au carrefour du droit de la concurrence et du droit des contrats, le régime juridique de la franchise recherche toujours son équilibre.
Oct 18, 2011
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | MARCOU, GERARD |
|---|
| Source / Fundstelle: | Société de législation comparée, coll. UMR de Droit comparé de Paris 1, 2011 |
|---|
| Année / Jahr: | 2011 |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Droit administratif, Droit comparé |
|---|

Extrait de l'introduction de Gérard MARCOU et Johannes MASING:
Ce livre est le résultat d'un projet de recherche commun réalisé par quatre professeurs allemands et quatre professeurs français de droit public, ainsi que trois jeunes chercheurs des deux pays, qui ont étudié les antécédents, le sens possible, la place dans l'ordre juridique et les justifications de ce qu'il est convenu d'appeler les «autorités de régulation indépendantes». Il s'agit d'une étude de droit comparé centré sur l'Allemagne et la France. La France a connu depuis au moins trente ans un développement de la régulation qui lui est propre, qui a affirmé son autonomie par rapport au modèle anglo-saxon, et qui a conduit à la création d'une quarantaine d'autorités indépendantes, dont certaines sont compétentes pour prendre des décisions relevant du droit de l'économie. Ces autorités sont en général dotées d'une très grande autonomie par rapport au gouvernement, qui ne soulève en tant que telle aucune réserve de principe. Elles donnent lieu à des discussions scientifiques approfondies en ce qui concerne leur forme, leurs missions et leurs pouvoirs. En Allemagne domine au contraire, sur ce sujet, une approche plutôt théorique dans la perspective dogmatique du droit constitutionnel. On se demande d'abord dans quelle mesure l'indépendance d'autorités administratives peut être admise du point de vue du principe de démocratie. La réponse est fondamentalement sceptique et, en dehors de la Bundesbank, la banque centrale, le droit allemand de l'organisation administrative ne connaît pratiquement aucune autorité administrative qui soit juridiquement indépendante. La question de la possibilité et du sens de l'indépendance des autorités de régulation gagne cependant en importance sous l'influence de l'internationalisation et du droit européen, et la création de l'Agence fédérale des réseaux (Bundesnetzagentur) l'a inscrite à l'ordre du jour. Et, si l'on y regarde de plus près, le droit actuel de l'organisation administrative est déjà plus nuancé qu'on ne l'affirme couramment dans la perspective du droit constitutionnel. La façon de poser le problème n'est donc pas du tout la même en France et en Allemagne, mais c'est d'abord la réalité de ces autorités administratives qui est différente dans les deux pays. C'est précisément pour ces raisons que ce projet nous a paru prometteur, et même nécessaire au regard de la coopération transnationale qui se développe en Europe.
Le projet ne se réduisait pas à présenter quelques communications au cours d'une réunion, puis à la publier. Il a donné lieu à une suite de réunions scientifiques très ciblées au sein d'un petit groupe d'universitaires spécialistes du droit de la régulation. Le but était de confronter de manière approfondie les différentes approches, de lire et discuter ensemble tous les textes qui étaient préparés, de se comprendre et de trouver des réponses. Nous sommes convaincus que de tels échanges, loin des conférences qui n'engagent à rien, sont trop rares dans la recherche scientifique en droit, non seulement dans le cadre national, mais davantage encore au-delà des frontières. De fait il existait au départ, et de part et d'autre, de nombreuses fausses représentations de la réalité institutionnelle, mais aussi des conceptions doctrinales. Ainsi certains collègues français partaient de l'idée, comme allant de soi, qu'il existait en Allemagne un grand nombre de puissantes autorités fédérales juridiquement indépendantes, tandis que certains collègues allemands partaient de l'idée que le paysage administratif français était organisé selon un modèle strictement hiérarchique, depuis le sommet de l'État, plus que ce n'est le cas en Allemagne. Les conceptions juridiques fondamentales divergeaient également de manière importante. Tandis que les collègues allemands - même s'il existait entre eux, dans le détail, des positions différentes au regard de la conception dominante -considéraient que la question du rattachement démocratique, en particulier de l'Autorité de sûreté nucléaire, méritait au moins discussion, les collègues français découvraient avec effroi que l'Établissement fédéral de surveillance des marchés financiers (Bundesanstalt für Finanzaufsicht) était placé sous la surveillance et soumis au pouvoir d'instruction du ministre des Finances : une solution qui, du point de vue français, soulevait beaucoup de discussions au regard de l'impératif d'impartialité des décisions administratives qui dérivent de l'État de droit. Il y avait aussi des sujets qui avaient pris une importance centrale dans un pays, mais étaient pratiquement ignorés dans l'autre pays, comme le problème de la procédure pour le prononcé des sanctions administratives, bien qu'il se réfère aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui sont d'application uniforme dans toute l'Europe. On pourrait aussi écrire tout un livre sur les difficultés linguistiques qu'il a fallu surmonter. Aux deux cultures juridiques correspondent deux cultures linguistiques ; bien qu'elles soient proches, une discussion approfondie de droit comparé conduit toujours dans un autre monde. Au moins dans le domaine du droit public, les notions juridiques fondamentales sont difficilement traduisibles et ne peuvent être rendues que par des analogies. Parce que les mots sont porteurs d'une signification juridique particulière, leur équivalent lexical ne suffit généralement pas à en rendre le sens.
Oct 10, 2011
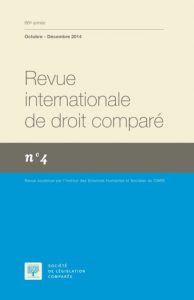 Résumé de l'auteur:
Résumé de l'auteur:
Pour rapprocher la justice davantage des justiciables, les juridictions de proximité ont été créées en France par la loi du 9 septembre 2002. Les juridictions de proximité sont exclusivement composées de juges non professionnels qui statuent sur certains litiges en premier et en dernier ressort. L'article compare les éléments spécifiques de cette nouvelle institution judiciaire avec le droit allemand. Ceci permet à la fois d'évaluer la juridiction de proximité du point de vue d'un observateur externe et de définir la notion "justice de proximité".
Plan de l'article:
Introduction
I. Définition de la notion de justice de proximité
II. La juridiction de proximité comme continuation des approches classiques d'une justice de proximité
III. Évaluation de la juridiction de proximité
1. Proximité structurelle de la juridiction de proximité
a) Recours à des juges non professionels
b) Compétence de la juridiction de proximité
c) Autres éléments de la proximité structurelle
d) Résumé
2. Proximité processuelle
a) Proximité processuelle par le biais du recours à des modes alternatifs de règlement des litiges
b) Proximité processsuelle par aménagement de la procédure devant la juridiction de proximité
3. Proximité par l'effectivité de la protection juridique
IV. Résultats et propositions concernant la juridiction de proximité
1. Résultats
2. Améliorations de la juridiction de proximité
Conclusion
Avr 8, 2011

ISBN 978-3-631-61180-7
Texte de la quatrième de couverture:
La protection des données à caractère personnel est elle destinée à une mort lente en raison de l’Internet ? En s’appuyant sur l’évolution du droit de la protection des données dans deux pays pionniers en ce domaine, l’Allemagne et la France, l’auteur met en exergue la dimension des tourmentes qu’a traversé et auxquelles est confronté ce droit depuis l’explosion de l’Internet. Car la protection des données semble faire les frais des problèmes croissants liés à la sécurité du réseau, à son caractère pseudo-anarchique mettant en péril la sécurité des biens, du territoire et des personnes. Cette thèse s’évertue à confronter les réponses législatives et techniques apportées par l’Allemagne et la France aux défis majeurs soulevés par Internet en relevant les forces et faiblesses des solutions envisagées. Dans le combat contre l’étiolement d’un droit fondamental à la protection des données, le juge aura maintes fois porté secours à ce droit agonisant à travers des décisions de principe et des jugements historiques comme celui de la cour constitutionnelle fédérale allemande relative aux perquisitions numériques.
Mar 18, 2011
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | MILLET, FRANÇOIS-XAVIER |
|---|
| Source / Fundstelle: | IN: Logiques Juridiques, L'Harmattan, 2011. |
|---|
| Année / Jahr: | 2011 |
|---|
| Type / Typ: | |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Droit comparé, Droit constitutionnel, Droit européen, Europarecht, Rechtsvergleichung, Verfassungsrecht |
|---|
| Mots clef / Schlagworte: | NORMENHIERARCHIE, Umsetzungsgesetze, Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen, Verfassungsmäßigkeitskontrolle, Effet Utile, HIERARCHIE DES NORMES, Le contrôle de constitutionnalité des lois, Lois de transposition |
|---|

ISBN : 978-2-296-55329-3
Le contrôle de constitutionnalité des lois doit garantir le respect de la hiérarchie des normes et l'autorité de la Constitution. Or son exercice se heurte aujourd'hui au droit dérivé de l'Union européenne. Le droit comparé permet de déterminer dans quelle mesure les juridictions constitutionnelles européennes acceptent de ne plus exercer leur contrôle de constitutionnalité des lois de transposition au nom de l'application uniforme du droit de l'Union, inhérente à sa nature même.

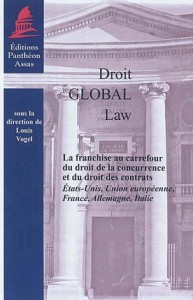 4e de couverture: Particulièrement adapté à la franchise, le droit comparé démontre, au-delà de conceptions nationales différentes, le rôle économique unique de cet instrument juridique. L'examen des droits américain, européen, français, allemand et italien révèle qu'ils se concentrent encore trop souvent sur la définition des obligations réciproques des parties sans tenir suffisamment compte du réseau dans lequel le contrat s'insère. Au carrefour du droit de la concurrence et du droit des contrats, le régime juridique de la franchise recherche toujours son équilibre.
4e de couverture: Particulièrement adapté à la franchise, le droit comparé démontre, au-delà de conceptions nationales différentes, le rôle économique unique de cet instrument juridique. L'examen des droits américain, européen, français, allemand et italien révèle qu'ils se concentrent encore trop souvent sur la définition des obligations réciproques des parties sans tenir suffisamment compte du réseau dans lequel le contrat s'insère. Au carrefour du droit de la concurrence et du droit des contrats, le régime juridique de la franchise recherche toujours son équilibre.