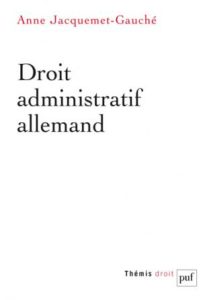Mar 20, 2025


Die Autorin erörtert eine klassische Problemstellung bezüglich der Aufgaben und Befugnisse des französischen Conseil d'État, der gleichzeitig die höchste Instanz der Verwaltungsgerichtsbarkeit und ein die Exekutive und z.T. sogar die Legislative beratendes Organ ist. Dabei beschreibt sie die Genese der Verwaltungsgerichtsbarkeit aus dem Verbot der Einmischung der ordentlichen Gerichte in die Angelegenheiten der Verwaltung und den langen Weg zu einer unabhängigen und eigenständigen Verwaltungsgerichtsbarkeit in Frankreich. Sie betont insbesondere, dass bis weit in das 20. Jahrhundert die Befugnisse der Verwaltungsgerichte in Bezug auf die Verwaltung, etwa hinsichtlich der Anordnung der aufschiebenden Wirkung von Rechtsbehelfen oder der Anordnung von Maßnahmen der Verwaltung, weit hinter dem deutschen Recht zurückblieben und sich in der kassatorischen Feststellung der Rechtswidrigkeit einer Verwaltungsmaßnahme erschöpfte.
Die Autorin zeigt sodann auf, dass durch die Gesetze vom 8. Februar 1995 und vom 30. August 2000 eine maßgebliche Stärkung der Befugnisse der Verwaltungsgerichtsbarkeit erfolgte. In diesen Kontext ordnet sie auch eine Rechtsprechungslinie in Bezug auf Verwaltungsverträge (contrats administratifs) ein, kraft derer das Gericht bei Mängeln anstelle der Auflösung bzw. Nichtigerklärung des Vertrags eine inhaltliche Anpassung desselben und nötigenfalls sogar trotz einseitiger Beendigung den weiteren Vollzug des Vertrags anordnen kann. Im letzten Teil verweist die Autorin auf drei Rechtsprechungslinien von aktueller und allgemeinpolitischer Bedeutung. Zunächst wird die relative Zurückhaltung des Conseil d'État bei seiner Rechtsprechung zu den Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie erläutert. Sodann wird auf die Rechtsprechung im Hinblick auf sogenannte Klimaklagen eingegangen. Hierbei betont die Autorin, dass die Verwaltungsgerichtsbarkeit zwar die unzureichenden Klimaschutzmaßnahmen der Exekutive beanstandet hat, sich jedoch weigerte, konkrete Maßnahmen zur Abhilfe anzuordnen. Schließlich erörtert die Autorin die Rechtsprechung zu diskriminierenden Personenkontrollen. Auch hier habe der Conseil d'État festgestellt, dass eine rechtswidrige Praxis nicht nur in Einzelfällen existiere, sich aber geweigert, der Verwaltung konkrete Maßnahmen zur strukturellen Beseitigung solcher Praktiken aufzugeben.
Der Beitrag schließt mit einem Ausblick auf die aus Sicht der Autorin stetig steigenden Relevanz der nicht rechtsprechenden, sondern beratenden Funktion des Conseil d'État. Zwar betont die Autorin die funktionale Trennung der rechtsprechenden und der beratenden Sektion, gleichzeitig aber die Einheit der Institution des Conseil d'État. Insoweit stellt sie fest, dass insbesondere über die Erarbeitung von Stellungnahmen anlässlich konkreter Gesetzesvorhaben, aber auch von selbständigen Berichten und Studien in vielfältiger Weise Vorschläge für eine moderne Verwaltung von dem Conseil d'État geäußert und in den politischen Diskurs eingebracht werden.
Mai 13, 2024
L'auteur présente le courant scientifique de la "nouvelle science du droit administratif" (
neue Verwaltungsrechtswissenschaft) dans le discours juridique allemand et examine dans quelle mesure cette approche peut être transposée à la science du droit administratif française. Il en conclut que les approches de la "nouvelle science du droit administratif" ne peuvent avoir qu'une portée sectorielle et limitée sur la science française du droit administratif en raison des difficultés méthodologiques qui lui sont inhérents.
Sep 29, 2023
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | COSSALTER, PHILIPPE; KORDEVA, MARIA |
|---|
| Source / Fundstelle: | IN: Droit administratif, n°1, 2023, p. 19-26 |
|---|
| Revue / Zeitschrift: | Les revues LexisNexis - Droit administratif |
|---|
| Année / Jahr: | 2023 |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Droit administratif |
|---|
 Résumé des auteurs:
Résumé des auteurs:
Comme chaque année, le choix des éléments à soumettre au lecteur dans le cadre de cette chronique a été difficile. Il n'y a pas dans la jurisprudence des juridictions administratives allemandes de «grands arrêts» marquant une évolution franche. Comme nous en avons pris l'habitude notre choix s’est porté sur des décisions permettant une lecture approfondie d’une question technique de droit administratif ou de contentieux administratif. Les décisions choisies illustrent également un certain nombre de questions de société propres à notre époque. L’arrêt de la Cour administrative fédérale du 13 avril 2021 sur la protection d’informations personnelles post mortem est aussi l’occasion d’évoquer les règles d’unité de la jurisprudence administrative. L’arrêt de la Cour administrative fédérale du 27 janvier 2021 traite du repos dominical face aux exigences de productivité d’Amazon. L’arrêt du 26 février 2021 pose l’absence de droit à réparation des préjudices subis par les collectivités publiques pour la durée excessive d’une procédure juridictionnelle. La situation des personnes publiques allemandes vis-à-vis de la protection des droits fondamentaux peut faire l’objet d’une fructueuse comparaison avec le droit français. Enfin l’arrêt du 28 octobre 2021 traite du statut d’information publique des messages échangés sur les réseaux sociaux, en l’espèce Twitter qui défraie actuellement la chronique.
La présentation approfondie de ces quatre arrêts est précédée d’une partie portant sur l’actualité (notamment législative et doctrinale) du droit administratif allemand.
Fév 19, 2022
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | JACQUEMET-GAUCHÉ, ANNE |
|---|
| Source / Fundstelle: | Presses Universitaires de France |
|---|
| Année / Jahr: | 2022 |
|---|
| Localisation / Standort: | Droit administratif allemand |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Droit administratif, Droit comparé, Procédure administrative |
|---|
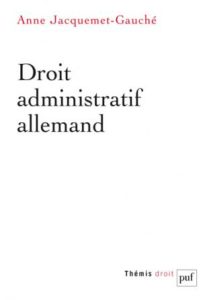
L'ouvrage propose une vision d’ensemble et synthétique du droit administratif allemand en explorant l’histoire du droit et de la science du droit administratif, les grandes notions de la matière, les institutions publiques, la procédure administrative, le contentieux administratif et le droit matériel, incluant de manière inédite des pans du droit administratif spécial.
Le droit allemand est présenté dans une perspective française, ce qui conduit notamment à la volonté constante de désamorcer d’éventuelles confusions pour le lecteur en lui donnant des repères à partir du droit français, à expliciter les choix de traduction et à proposer un glossaire détaillé en fin d’ouvrage. Pour les plus initiés, plusieurs réflexions sont livrées, aussi bien sur le droit allemand que sur le droit administratif français. In fine, cet ouvrage conduit à s’interroger plus généralement sur les éléments qui forgent l’identité du droit administratif et sur la persistance de cultures juridiques propres à chacun de ces deux États à l’heure de l’intégration européenne.
Juin 9, 2021

La justice numérique vise à améliorer l'accès à la justice et constitue un élément essentiel du fonctionnement de celle-ci. En octobre 2020, le Conseil de l'Union européenne a appelé à saisir les possibilités offertes par la numérisation pour améliorer l'accès à la justice. En tant que mode d'exécution des tâches juridictionnelles, l'E-Justiz soulève avant tout le défi de sa mise en oeuvre technique et organisationnelle définie par la loi et incombant aux Länder. Le cadre législatif n'efface pas les disparités entre les différentes juridictions et leurs missions, mais aussi les différences entre les Etats fédérés. La numérisation de la justice recouvre ainsi plusieurs problématiques: le recours aux technologies de l'information pour faire face aux "tâches bureaucratiques" de la justice, la numérisation et la communication avec le public, l'obtention et la préparation des données juridiques. Le rôle de l'intelligence artificielle constitue également un point de réflexion car en vertu de l'article 97 de la Loi fondamentale le pouvoir judiciaire est confié aux juges qui sont des personnes physiques. L'utilisation d'algorithmes ne peut par conséquent remplacer les juges dans l'accomplissement de cette mission. La numérisation peut soulever des interrogations relatives à la maîtrise des données et au contrôle de l'activité judiciaire.
Finalement, il s'agit d'un processus de développement organisationnel dont la forme et la vitesse d'évolution doivent être maîtrisées. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un domaine sensible de l'Etat de droit et que la numérisation n'est pas dépourvue de tout risque pour la justice.