Oct 27, 2019
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | ABDEREMANE, KARINE; CLAEYS, ANTOINE; LANGELIER, ELISE; MARIQUE, YSEULT; PERROUD, THOMAS; KORDEVA, MARIA |
|---|
| Source / Fundstelle: | Bruylant, collection Pratique du droit européen |
|---|
| Année / Jahr: | 2019 |
|---|
| Localisation / Standort: | Manuel de droit comparé des administrations européennes |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Droit administratif, Droit comparé |
|---|
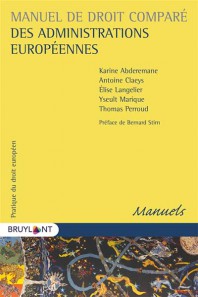
Un prenant pour repère le droit administratif français, cet ouvrage propose une approche comparée des droits des administrations de cinq États européens : l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Une telle exploration horizontale a paru nécessaire, à l'heure où la doctrine européenne reconnaît l'émergence d'un droit administratif européen et que l'influence croissante des droits de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe sur le droit de leurs États membres semble bien identifiée. L'intensité des échanges, notamment économiques, sociaux et culturels, se renforce entre ceux-ci et impose une meilleure connaissance et compréhension réciproque. C'est particulièrement vrai pour le droit administratif dont «
l'intelligence interne » - pour reprendre l'expression de Jean Rivero se comprend à l'aune des influences croisées (européennes, transnationales, etc.) comme à celles des spécificités de l'histoire et des traditions juridiques nationales.
C'est afin de rendre compte de la richesse de cette construction que ce manuel offre une présentation claire des concepts, des techniques et des régimes juridiques qui articulent le droit des administrations dans les cinq États-types étudiés. Il donne aux étudiants, praticiens et universitaires, les outils pédagogiques et analytiques afin de mieux comprendre les mutations actuelles des droits publics nationaux et européens.
Les auteurs de cet ouvrage, tous enseignant-chercheurs en droit public interne et en droits européens, partagent une passion commune pour le droit comparé.
Préface de Bernard Stirn.
L'ouvrage rassemble les contributions de Karine Abderemane, Maître de conférences en droit public à l'université de Tours / IRJI François-Rabelais, Antoine Claeys, Professeur de droit public à l'université de Poitiers / IDP, Maria Kordeva, Collaboratrice scientifique à l'université de la Sarre / FOV Speyer, Élise Langelier, Professeur de droit public à l'université de Limoges / OMIJ, Yseult Marique, Senior Lecturer à l'université d'Essex / FOV Speyer et Thomas Perroud, Professeur de droit public à l'université de Paris II Panthéon-Assas / CERSA. Il a été réalisé avec la collaboration de Federica Rassu, Maître de conférences en droit public à l'université de Poitiers / IDP.Juil 16, 2019
 Résumé :
Résumé :
Les auteurs ont participé à un dossier détaillé sur la responsabilité du fait des lois inconstitutionnelles ou inconventionnelles dans plusieurs pays européens en apportant une introduction au droit de la responsabilité de l'État d'un point de vue allemand. Ils démontrent qu'en principe une telle responsabilité est possible en droit allemand, mais elle est de fait tellement encadrée par des conditions strictes que cela conduit en pratique à une non-responsabilité. C'est donc au législateur de créer un régime de responsabilité effectif - ce qui n'a pas encore été fait sur le plan fédéral.
Jan 14, 2019
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | KORDEVA, MARIA; COSSALTER, PHILIPPE |
|---|
| Source / Fundstelle: | RFDA, n°6 2018, p. 1016 - 1020 |
|---|
| Revue / Zeitschrift: | Revue Française de Droit Administratif |
|---|
| Année / Jahr: | 2018 |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Droit administratif, Droit constitutionnel |
|---|
| Mots clef / Schlagworte: | GOUVERNEMENT, POUVOIR |
|---|
 Introduction de l'article :
Introduction de l'article :
La Constitution de la République fédérale d’Allemagne et les constitutions des États fédérés allemands (Länder) règlent de manière différente les rapports entre le parlement nouvellement élu et un gouvernement sortant. Il existe de nombreux cas de figure.
La Loi fondamentale du 23 mai 1949 (art. 69, al. 2 et 3), la Constitution de Bade-Wurtemberg, la Constitution de Rhénanie du Nord-Westphalie (art. 62, al. 2) et la Constitution de Sarre (art. 87, al. 3, première phrase) disposent que les fonctions du chef du gouvernement ne se terminent qu’avec le début de la législature. Par les élections, qui donnent la composition d’un nouveau Parlement, s’achève le mandat du chef du gouvernement qui n’est plus considéré comme « titulaire de la fonction » (
Amtsinhaber)
. La Constitution de Bavière (art. 44) introduit la notion de durée du gouvernement, celle de Brême ouvre la possibilité d’élire un chef du gouvernement pour la durée d’une législature (art. 107, al. 2), tandis que les Constitutions de Hesse (art. 113, al. 2) et de Basse-Saxe (art. 24, al. 2) optent pour la démission du Premier-ministre déclenchée par l’entrée en fonction du nouveau Parlement (
Landtag), ce qui signifie que l’ouverture de la nouvelle législature n’agit pas comme une « perte de la fonction » (
Amtsverlust) mais convient d’être perçue comme entraînant une obligation constitutionnelle concrète : la démission. Les textes constitutionnels de Berlin (art. 41, al. 1
er), Hambourg (art. 34), Rhénanie-Palatinat (art. 98, al. 2) et Schleswig-Holstein (art. 21, al. 2) ne prévoient ni une obligation de démission incombant au Premier-ministre après le début de la nouvelle législature, ni ne contiennent des dispositions précises relative à la durée d’exercice des fonctions gouvernementales. Il s’agit d’une tradition provenant des textes constitutionnels de
Länder de l’époque weimarienne.
Plan de l'article :
- Signification de l'article 69, alinéa 3, LF : commodité constitutionnelle ou difficulté organisationnelle
- La raison pratique de l'existence d'une disposition constitutionnelle prévoyant la fin des fonctions du gouvernement fédéral
- Les modalités de composition du gouvernement intérimaire
- L'illusoire plénitude des compétences constitutionnelles du gouvernement intérimaire agissant dans le cadre de l'article 69, alinéa 3, LF
- Les compétences constitutionnelles du gouvernement intérimaire
- Les limites dans l'exercice des compétences du gouvernement intérimaire
Oct 11, 2018
 Résumé / commentaire des auteurs:
Résumé / commentaire des auteurs:
La limitation du pouvoir de la Cour administrative fédérale à la clarification des seules questions de droit, justifiée au regard du droit procédural administratif général, est contreproductive dans la procédure juridictionnelle d'asile. Des discussions sont donc en cours au niveau politique pour déterminer s'il convient, par une modification des textes, d'attribuer à la Cour administrative fédérale un pouvoir limité d'enquête et de décision afin qu'elle puisse également contribuer à la sécurité et l'harmonisation juridiques sur des questions factuelles d'importance fondamentale.
Décisions abordées:
- Cour administrative fédérale, décision du 21 novembre 2017 - 1 C 39.16 (obligation faite aux juridictions d'établir l'existence d'une protection internationale accordée dans un autre État membre de l'Union européenne)
- Cour administrative fédérale, décision du 27 juin 2017 - 1 C 26.16 (questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne relatives aux migrations secondaires de bénéficiaires du statut de réfugié)
- Cour administrative fédérale, décision du 24 avril 2017 - 1 B 24.17 (irrecevabilité d'un pourvoi en cassation pour une question de fait d'importance fondamentale)
Août 31, 2018
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | FROMONT, MICHEL |
|---|
| Revue / Zeitschrift: | Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, n°4 |
|---|
| Année / Jahr: | 2018 |
|---|
| Localisation / Standort: | Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Droit administratif, Droit civil, Droit constitutionnel, droit politique |
|---|

- Les droits de la minorité dans les commissions d'enquête
La Cour de justice fédérale, juridiction suprême en matière civile et pénale, a eu à arbitrer en 2017 une querelle au sujet du fonctionnement de la commission d'enquête créée le 20 mars 2014 par le Bundestag pour enquêter sur les activités d'espionnage des services de renseignements des États dits des "Cinq Yeux": États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande. Conformément à l'article 44 de la Loi fondamentale, la commission avait été créée par demande des députés de l'opposition réunissant un quart des membres du Bundestag. La décision d'entendre Edward Snowden fut prise le 8 mai 2014, mais la commission se divisa sur l'opportunité de l'interroger en Allemagne ou en Russie. Deux propositions s'affrontèrent, celle de la majorité qui ne voulait pas l'interroger en Allemagne et celle de la minorité qui demandait que le gouvernement organise le voyage de Snowden de Moscou à Berlin. Le juge d'instruction de la Cour fut alors saisi d'un recours de la part de la minorité et le 11 novembre 2016, il donna raison à la minorité et, en conséquence, ordonna à la commission de faire procéder à l'audition de Snowden en Allemagne. La majorité contesta cette décision devant la Cour fédérale de justice et obtint gain de cause non pour des raisons de fond, mais pour des raisons de compétence. La Cour était en présence de deux textes contradictoires: l'article 44, alinéa 1 de la Loi fondamentale qui dispose: "Le Bundestag a le droit et, à la demande d'un quart de ses membres, l'obligation de constituer une commission d'enquête chargée de recueillir les preuves nécessaires en audience publique" et le §15, alinéa 2 de la loi sur les commissions d'enquête du Bundestag qui dispose: "Les preuves sont à recueillir lorsqu'elles sont demandées par un quart des membres de la commission d'enquête, à moins que la recherche des preuves soit irrecevable ou que les moyens de preuve soient inaccessibles même en employant les moyens de contrainte prévues dans cette loi". Le 23 février 2017, La Cour fédérale de justice a eu à se prononcer sur la constitutionnalité de l'application des dispositions de la loi sur les commissions d'enquête. La Cour a préféré combiner les deux règles en donnant à la loi sur les commissions d'enquête une interprétation "conforme à la constitution" qui exige que la demande soit faite par "un quart des membres du Bundestag". Cette décision est caractéristique des raisonnements des juristes allemands: ceux-ci n'hésitent pas à recourir à des argumentations complexes pour parvenir à un résultat qui n'est pas évident à la simple lecture des textes.
Pour consulter cette décision:
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2017-2-23&client=%5B%273%27%2C+%273%27%5D&nr=77709&pos=3&anz=27
2. Le droit d'un mourant d'acquérir des doses mortelles de stupéfiants
Le 2 mars 2017, la Cour administrative fédérale a cassé le jugement d'une cour administrative d'appel qui avait approuvé l'Office fédéral des médicaments et des produits médicaux pour avoir refusé à une malade incurable 15 g de Natrium-Pentobarbital afin de pouvoir se suicider seule. L'intéressée avait eu un très grave accident en 2002 et la partie de son corps en dessous de son cou était restée entièrement paralysée, victime de grandes souffrances physiques. À la fin de 2004, l'Office fédéral des médicaments et des produits médicaux a refusé de lui fournir la dose mortelle de poison qu'elle avait sollicité et en 2005, elle s'est résignée à aller en Suisse pour se suicider avec l'aide de l'association suisse Dignitas. Son mari avait ensuite formé une action déclaratoire auprès des juridictions administratives, mais le tribunal administratif, puis la cour administrative d'appel avaient jugé que le mari n'avait pas le droit d'agir en justice contre le refus de l'Office fédéral. La Cour constitutionnelle fédérale fut alors saisie, mais le recours individuel pour violation des droits fondamentaux ne fut même pas admis à une procédure d'examen. Le mari s'adressa à la Cour européenne des droits de l'homme. Le 17 décembre 2012, elle jugea que le mari était recevable à faire valoir l'atteinte qui avait été portée à son droit au respect de sa vie privée. Le mari saisit alors de nouveau le tribunal administratif et la cour administrative d'appel qui rejetèrent sa plainte en se fondant sur les modifications apportées par la loi sur les stupéfiants afin de rendre plus facile l'accès aux soins palliatifs. Le mari forma un pourvoi en cassation devant la Cour administrative fédérale et obtint satisfaction: les décisions des juridictions administratives du fond furent cassées par la Cour administrative fédérale et le refus de l'Office fédéral fut annulé.
Pour consulter la décision:
https://www.bverwg.de/020317U3C19.15.0
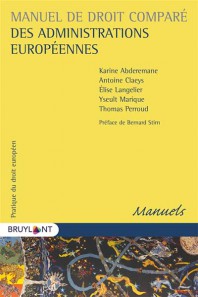 Un prenant pour repère le droit administratif français, cet ouvrage propose une approche comparée des droits des administrations de cinq États européens : l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Une telle exploration horizontale a paru nécessaire, à l'heure où la doctrine européenne reconnaît l'émergence d'un droit administratif européen et que l'influence croissante des droits de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe sur le droit de leurs États membres semble bien identifiée. L'intensité des échanges, notamment économiques, sociaux et culturels, se renforce entre ceux-ci et impose une meilleure connaissance et compréhension réciproque. C'est particulièrement vrai pour le droit administratif dont « l'intelligence interne » - pour reprendre l'expression de Jean Rivero se comprend à l'aune des influences croisées (européennes, transnationales, etc.) comme à celles des spécificités de l'histoire et des traditions juridiques nationales.
C'est afin de rendre compte de la richesse de cette construction que ce manuel offre une présentation claire des concepts, des techniques et des régimes juridiques qui articulent le droit des administrations dans les cinq États-types étudiés. Il donne aux étudiants, praticiens et universitaires, les outils pédagogiques et analytiques afin de mieux comprendre les mutations actuelles des droits publics nationaux et européens.
Les auteurs de cet ouvrage, tous enseignant-chercheurs en droit public interne et en droits européens, partagent une passion commune pour le droit comparé.
Préface de Bernard Stirn.
L'ouvrage rassemble les contributions de Karine Abderemane, Maître de conférences en droit public à l'université de Tours / IRJI François-Rabelais, Antoine Claeys, Professeur de droit public à l'université de Poitiers / IDP, Maria Kordeva, Collaboratrice scientifique à l'université de la Sarre / FOV Speyer, Élise Langelier, Professeur de droit public à l'université de Limoges / OMIJ, Yseult Marique, Senior Lecturer à l'université d'Essex / FOV Speyer et Thomas Perroud, Professeur de droit public à l'université de Paris II Panthéon-Assas / CERSA. Il a été réalisé avec la collaboration de Federica Rassu, Maître de conférences en droit public à l'université de Poitiers / IDP.
Un prenant pour repère le droit administratif français, cet ouvrage propose une approche comparée des droits des administrations de cinq États européens : l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Une telle exploration horizontale a paru nécessaire, à l'heure où la doctrine européenne reconnaît l'émergence d'un droit administratif européen et que l'influence croissante des droits de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe sur le droit de leurs États membres semble bien identifiée. L'intensité des échanges, notamment économiques, sociaux et culturels, se renforce entre ceux-ci et impose une meilleure connaissance et compréhension réciproque. C'est particulièrement vrai pour le droit administratif dont « l'intelligence interne » - pour reprendre l'expression de Jean Rivero se comprend à l'aune des influences croisées (européennes, transnationales, etc.) comme à celles des spécificités de l'histoire et des traditions juridiques nationales.
C'est afin de rendre compte de la richesse de cette construction que ce manuel offre une présentation claire des concepts, des techniques et des régimes juridiques qui articulent le droit des administrations dans les cinq États-types étudiés. Il donne aux étudiants, praticiens et universitaires, les outils pédagogiques et analytiques afin de mieux comprendre les mutations actuelles des droits publics nationaux et européens.
Les auteurs de cet ouvrage, tous enseignant-chercheurs en droit public interne et en droits européens, partagent une passion commune pour le droit comparé.
Préface de Bernard Stirn.
L'ouvrage rassemble les contributions de Karine Abderemane, Maître de conférences en droit public à l'université de Tours / IRJI François-Rabelais, Antoine Claeys, Professeur de droit public à l'université de Poitiers / IDP, Maria Kordeva, Collaboratrice scientifique à l'université de la Sarre / FOV Speyer, Élise Langelier, Professeur de droit public à l'université de Limoges / OMIJ, Yseult Marique, Senior Lecturer à l'université d'Essex / FOV Speyer et Thomas Perroud, Professeur de droit public à l'université de Paris II Panthéon-Assas / CERSA. Il a été réalisé avec la collaboration de Federica Rassu, Maître de conférences en droit public à l'université de Poitiers / IDP.




