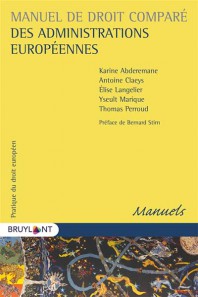Août 24, 2020

Le droit procédural n'est pas une fin en soi. Il permet de garantir le respect des droits des parties à l'instance mais également de s'assurer de la bonne compréhension des faits pertinents par le juge afin que le droit matériel y afférent soit correctement appliqué aux faits établis. La distinction entre établissement des faits et application du droit est commune à tous les codes de procédure dans le monde. Le présent article porte sur la détermination de la règle de droit applicable. La thèse selon laquelle le principe
iura novit curia serait un bien commun de la pensée juridique de l'Europe continentale - contrairement aux pays de
common law - est trop générale. S'agissant du droit procédural allemand, elle est en principe exacte, mais le juge administratif français - contrairement à son collègue allemand - statue, avant tout, au regard des moyens des parties, à l'exception des moyens d'ordre public qu'il doit soulever d'office. Si, selon le droit procédural allemand, le principe
iura novit curia s'applique sans restriction dans la procédure en première instance, en appel ou en cassation quant au droit allemand, il en va naturellement de même pour les normes de droit international public ou le droit de l'Union européenne, contrairement à la pratique du Conseil d'Etat français qui examine uniquement les traités ou accords internationaux ou le droit de l'Union sur un grief d'une partie.
Juil 24, 2020

« […] [L]a gestion de l’épidémie de Covid-19 constituait un laboratoire idoine permettant de voir à quel point les libertés fondamentales du bloc de constitutionnalité sont prises au sérieux par les pouvoirs publics dans une situation de vulnérabilité particulière. » La contribution présente, à partir du droit positif, une perspective franco-allemande montrant la différence d’approche des juges français et allemands confrontés à des questions relatives à la constitutionnalité de mesures privatives de libertés : le principe de proportionnalité est l’outil indispensable permettant l’examen de ces mesures.
En ce qui concerne l’Allemagne, son organisation fédérale et les attributions internes de compétences donnent au juge constitutionnel fédéral et aux cours constitutionnelles des Länder une place qui, en France, est en partie dévolue au juge administratif au travers du référé-liberté. Le Conseil constitutionnel français vient compléter ce paysage juridictionnel, mais ne rassure guère quant à sa pratique du principe de proportionnalité qui semble manquer d’épaisseur (décision n°2020-799 DC du 26 mars 2020 : « compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de juger que cette loi organique a été adoptée en violation des règles de procédure prévues à l’article 46 de la Constitution »). Dans des circonstances exceptionnelles, c’est le principe de proportionnalité qui peut permettre au juge d’évaluer la gravité des atteintes portées aux libertés et de se démarquer du discours politique en s’érigeant en contre-pouvoir. Par conséquent, « garantir les libertés individuelles implique, pour l’organe qui en est chargé, le courage de prendre une décision nécessairement politique, dont l’ampleur se mesure à la rigueur du contrôle de proportionnalité exercé compte tenu des contraintes liées à l’urgence ». Mais, excepté les situations extraordinaires, le principe de proportionnalité peut être utilisé par le juge afin de garantir le respect de l’attribution de compétences attribuées à des organes supra-nationaux. Ainsi, dans la décision du 5 mai 2020 portant sur le programme d’acquisition d’obligations souveraines sur les marchés secondaires (
Public Sector Asset Purchase Program,
PSPP) rendue par la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne, le lecteur trouve le désaveu de la juridiction nationale du contrôle de proportionnalité exercé par la Cour de justice de l’Union européenne. La lecture de l’arrêt du juge allemand fait montre de l’intention de défendre les compétences régaliennes par le biais des principes actés par le constituant en prohibant aux autorités nationales de participer à la mise en œuvre d’une politique européenne qui ne répondrait pas aux exigences de la compétence d’attribution fixée par l’article 5 du Traité de l’Union européenne.
La contribution est axée sur deux thèmes : la proportionnalité pour défendre les libertés de l’individu (I) et la proportionnalité pour préserver les compétences de l’État (II). Le contrôle de proportionnalité est, en droit constitutionnel, un instrument de pouvoir par lequel l’autorité de la décision, politique ou juridique, ne résulte pas de celle de son auteur mais de sa justification. Cependant, il convient de toujours procéder à une mise en balance délicate entre la rigidité du contrôle opéré par le juge et l’approbation sans nuance d’une décision politique qui équivaut dans ce cas à un contrôle de pure opportunité.
Jan 17, 2020
Le "principe de précaution" allemand et la "théorie du bilan" française sont
a priori deux notions distinctes cependant des problèmes juridiques transversaux les ont peu à peu rapprochées en droit administratif espagnol. D'un point de vue de droit comparé, il semblerait aue nous assistions à l'émergence d'une imbrication des deux notions qui, bien que différentes, se complètent pour apporter des réponses appropriées aux situations juridiques nouvelles. L'enjeu d'une telle analyse est d'utiliser le laboratoire du droit administratif espagnol pour révéler les migrations notionnelles qui se jouent entre espaces juridiques, plus spécifiquement s'agissant de la régulation du risque, de la protection des droits fondamentaux et de la garantie de l'intérêt général. Il s'agit par cette démarche de saisir les enjeux actuels de l'européisation du droit administratif en l'illustrant par une analyse de la circulation du principe de précaution et de la théorie du bilan dans la jurisprudence du Tribunal Suprême Espagnol. En ce sens, le droit public comparé est devenu un dispositif théorique pour penser
ius publicum commun en Europe.
Oct 27, 2019
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | ABDEREMANE, KARINE; CLAEYS, ANTOINE; LANGELIER, ELISE; MARIQUE, YSEULT; PERROUD, THOMAS; KORDEVA, MARIA |
|---|
| Source / Fundstelle: | Bruylant, collection Pratique du droit européen |
|---|
| Année / Jahr: | 2019 |
|---|
| Localisation / Standort: | Manuel de droit comparé des administrations européennes |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Droit administratif, Droit comparé |
|---|
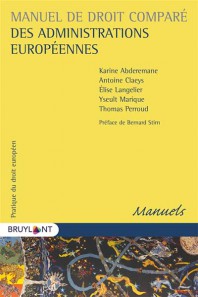
Un prenant pour repère le droit administratif français, cet ouvrage propose une approche comparée des droits des administrations de cinq États européens : l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Une telle exploration horizontale a paru nécessaire, à l'heure où la doctrine européenne reconnaît l'émergence d'un droit administratif européen et que l'influence croissante des droits de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe sur le droit de leurs États membres semble bien identifiée. L'intensité des échanges, notamment économiques, sociaux et culturels, se renforce entre ceux-ci et impose une meilleure connaissance et compréhension réciproque. C'est particulièrement vrai pour le droit administratif dont «
l'intelligence interne » - pour reprendre l'expression de Jean Rivero se comprend à l'aune des influences croisées (européennes, transnationales, etc.) comme à celles des spécificités de l'histoire et des traditions juridiques nationales.
C'est afin de rendre compte de la richesse de cette construction que ce manuel offre une présentation claire des concepts, des techniques et des régimes juridiques qui articulent le droit des administrations dans les cinq États-types étudiés. Il donne aux étudiants, praticiens et universitaires, les outils pédagogiques et analytiques afin de mieux comprendre les mutations actuelles des droits publics nationaux et européens.
Les auteurs de cet ouvrage, tous enseignant-chercheurs en droit public interne et en droits européens, partagent une passion commune pour le droit comparé.
Préface de Bernard Stirn.
L'ouvrage rassemble les contributions de Karine Abderemane, Maître de conférences en droit public à l'université de Tours / IRJI François-Rabelais, Antoine Claeys, Professeur de droit public à l'université de Poitiers / IDP, Maria Kordeva, Collaboratrice scientifique à l'université de la Sarre / FOV Speyer, Élise Langelier, Professeur de droit public à l'université de Limoges / OMIJ, Yseult Marique, Senior Lecturer à l'université d'Essex / FOV Speyer et Thomas Perroud, Professeur de droit public à l'université de Paris II Panthéon-Assas / CERSA. Il a été réalisé avec la collaboration de Federica Rassu, Maître de conférences en droit public à l'université de Poitiers / IDP.Mar 1, 2019
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | LEPSIUS, OLIVER; DREIER, HORST; MÖLLERS, CHRISTOPH; KUCH, DAVID; GAILLET AURORE |
|---|
| Revue / Zeitschrift: | Revue française de droit constitutionnel, 2019/1, p. 199-213 |
|---|
| Année / Jahr: | 2019 |
|---|
| Localisation / Standort: | Revue française de droit constitutionnel |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Droit comparé, Droit constitutionnel, Droit électoral, droit politique, Procédure constitutionnelle |
|---|

Résumé de l'auteur:
La richesse de la comparaison franco-allemande a nourri de longue date les chroniques de droit constitutionnel comparé. La seule mention des spécificités du fédéralisme allemand face au caractère centralisé de l’État français, des conceptions différentes de l’État, de la place du droit, dans ses rapports avec la politique, la démocratie et la doctrine ou encore du rôle des juges, notamment constitutionnels, suffit à esquisser la variété des horizons à approfondir à cet égard. Le contexte des célébrations respectives des soixante-dixième et soixantième anniversaires de la Loi fondamentale allemande de 1949 et de la Constitution de la V
e République de 1958 constitue sans conteste une nouvelle occasion de mettre en perspective ce qui peut rapprocher ou distinguer les deux ordres constitutionnels actuels.
En France comme en Allemagne, les élections de 2017 – présidentielle et législatives en France, législatives en Allemagne – ont bousculé les institutions. Afin de saisir au plus près les défis d’envergure posés au système allemand depuis les élections du 24 septembre 2017, cette chronique a été ouverte à trois auteurs allemands. Ils ont ce faisant été libres de proposer leur regard de spécialistes sur les évolutions marquantes du droit constitutionnel en 2017-2018.
Traduction par Aurore Gaillet.

 Le droit procédural n'est pas une fin en soi. Il permet de garantir le respect des droits des parties à l'instance mais également de s'assurer de la bonne compréhension des faits pertinents par le juge afin que le droit matériel y afférent soit correctement appliqué aux faits établis. La distinction entre établissement des faits et application du droit est commune à tous les codes de procédure dans le monde. Le présent article porte sur la détermination de la règle de droit applicable. La thèse selon laquelle le principe iura novit curia serait un bien commun de la pensée juridique de l'Europe continentale - contrairement aux pays de common law - est trop générale. S'agissant du droit procédural allemand, elle est en principe exacte, mais le juge administratif français - contrairement à son collègue allemand - statue, avant tout, au regard des moyens des parties, à l'exception des moyens d'ordre public qu'il doit soulever d'office. Si, selon le droit procédural allemand, le principe iura novit curia s'applique sans restriction dans la procédure en première instance, en appel ou en cassation quant au droit allemand, il en va naturellement de même pour les normes de droit international public ou le droit de l'Union européenne, contrairement à la pratique du Conseil d'Etat français qui examine uniquement les traités ou accords internationaux ou le droit de l'Union sur un grief d'une partie.
Le droit procédural n'est pas une fin en soi. Il permet de garantir le respect des droits des parties à l'instance mais également de s'assurer de la bonne compréhension des faits pertinents par le juge afin que le droit matériel y afférent soit correctement appliqué aux faits établis. La distinction entre établissement des faits et application du droit est commune à tous les codes de procédure dans le monde. Le présent article porte sur la détermination de la règle de droit applicable. La thèse selon laquelle le principe iura novit curia serait un bien commun de la pensée juridique de l'Europe continentale - contrairement aux pays de common law - est trop générale. S'agissant du droit procédural allemand, elle est en principe exacte, mais le juge administratif français - contrairement à son collègue allemand - statue, avant tout, au regard des moyens des parties, à l'exception des moyens d'ordre public qu'il doit soulever d'office. Si, selon le droit procédural allemand, le principe iura novit curia s'applique sans restriction dans la procédure en première instance, en appel ou en cassation quant au droit allemand, il en va naturellement de même pour les normes de droit international public ou le droit de l'Union européenne, contrairement à la pratique du Conseil d'Etat français qui examine uniquement les traités ou accords internationaux ou le droit de l'Union sur un grief d'une partie.