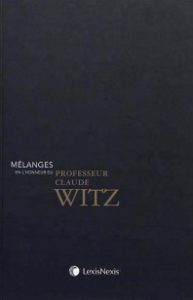Jan 8, 2019
 Résumé :
Résumé :
Tout est comparable du moment où la question posée est bonne. Elle doit être posée de manière explicite afin de ne pas induire le lecteur en erreur et doit être la plus neutre possible en évitant des connotations dans un État ou un autre. L'auteure donne à travers sa contribution en hommage à Gérard Marcou une première ébauche de réflexion sur le droit des biens publics en Allemagne. Après une brève présentation du système juridique en Allemagne trois questions sont abordées avec un accent sur le droit des biens publics, matière relevant du droit adminsitratif spécial.
- Comment est organisée la propriété publique?
- Quels sont les pouvoirs de la personne publique?
- Quelle utilisation privative des biens publics?
Déc 13, 2018
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | DEMME GÉRALDINE |
|---|
| Source / Fundstelle: | LexisNexis, 2018, pp. 258-264 |
|---|
| Année / Jahr: | 2018 |
|---|
| Localisation / Standort: | Mélanges en l'honneur du Professeur Claude Witz |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Droit comparé, Droit de la concurrence |
|---|
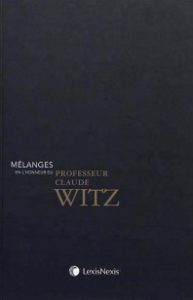
Le droit comparé est un puits inépuisable de différentes solutions aux problèmes similaires ou identiques. Il est ainsi source d'inspiration pour les législateurs en quête de nouvelles ou de meilleures règles juridiques. Dans le processus d'harmonisation et d'uniformisation du droit de l'Union européenne, le droit comparé joue un rôle décisif. À côté d'autres solutions envisageables, le droit de l'Union européenne se nourrit essentiellement de solutions nationales existantes. Que ce soit en France ou en Allemagne, le droit des ententes a pour mission de veiller à ce que les accords entre entreprises ne restreignent pas le libre jeu de la concurrence. On distingue deux différents types d'accords: les ententes verticales qui ont lieu entre acteurs du marché opérant à différents niveaux de la chaîne de production ou de distribution et les ententes horizontales conclues entre entreprises intervenant au même stade du marché, c'est-à-dire principalement entre concurrents. Tandis que le législateur français a rédigé l'interdiction générale des ententes restrictives sans distinguer la nature verticale ou horizontale de l'accord, l'ancienne loi allemande contre les restrictions de concurrence ne prohibait que les restrictions horizontales. Les restrictions verticales étaient soumises à un simple contrôle de l'abus qui n'ouvrait qu'une possibilité d'intervention limitée aux autorités de concurrence. C'est par le biais du droit de l'Union européenne que droits français et allemand se sont rapprochés tout en gardant une empreinte propre et culturelle.
Déc 13, 2018
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | POILLOT ELISE |
|---|
| Source / Fundstelle: | LexisNexis, 2018, pp. 671-700 |
|---|
| Année / Jahr: | 2018 |
|---|
| Localisation / Standort: | Mélanges en l'honneur du Professeur Claude Witz |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Droit civil, Droit comparé, Droit de la consommation |
|---|
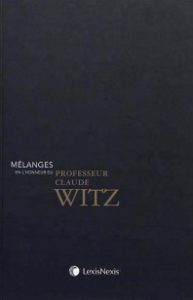
Le constat du caractère perturbateur du droit de la consommation n'est pas nouveau. Rassemblant des lois ayant pour fonction de protéger les consommateurs, le droit de la consommation "a vocation à recouper les disciplines traditionnelles [...] our instiller en chacune d'elles les techniques de protection" (Natacha Sauphanor-Brouillard). Comment alors intégrer le droit de la consommation dans le système juridique? Une grande majorité d'États a fait le choix de codifier ou de regrouper les dispositions relatives aux droits des consommateurs dans un corps de textes particulier, ainsi et entre autres, l'Espagne, la Belgique et le Royaume-Uni, prenant pour certains d'entre eux - la France, l'Italie et le Luxembourg, la forme de codes. D'autres, comme l'Allemagne, l'Autriche et les Pays-Bas, ont en revanche choisi une approche de type à la fois séparatiste et intégrationniste. Ces États ont détaché les dispositions de droit de la consommation de souche civiliste de celles relevant d'autres branches du droit. Un regard croisé sur les expériences allemande et française montre que d'un côté du Rhin comme de l'autre, les tentatives de mise en ordre du droit de la consommation n'ont pas été chose aisée. Dans les deux pays le droit de la consommation est à l'origine d'une remise en ordre du système juridique qui a, en Allemagne, principalement donné lieu à une réforme du
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) et, en France, conduit à l'adoption d'un Code de la consommation. En Allemagne, la recomposition du BGB a, dans un premier temps, semblé lui rendre une certaine vigueur. Avec du recul, elle apparaît toutefois l'avoir entraîné à la recherche d'une identité qu'il aurait perdue à trop vouloir la conserver. En France, le Code de la consommation semble désormais avoir trouvé toute sa place dans le paysage juridique français même s'il a longtemps été en quête de sens.
Déc 13, 2018
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | LASSERRE VALERIE |
|---|
| Source / Fundstelle: | LexisNexis, 2018, pp. 467-504 |
|---|
| Année / Jahr: | 2018 |
|---|
| Localisation / Standort: | Mélanges en l'honneur du Professeur Claude Witz |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Droit comparé, Droit des obligations, Droit privé |
|---|
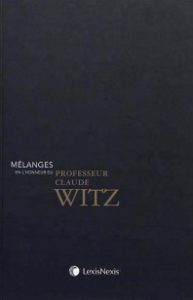
Le droit français de la cession de créance a fait l'objet d'une refonte par l'ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations du 10 février 2016, dans le sens de la simplification de la cession et de l'objectivation de l'engagement. Cette réforme est une nouvelle occasion de réfléchir sur les différences qui existent avec le droit allemand de la cession de créance. La cession de créance ne se trouve plus dans le droit de la vente; elle est désormais réglementée dans le Code civil français aux articles 1321 et suivants, parmi les dispositions du régime général des obligations dénommés "opérations sur obligation". En droit allemand, cette opération présentée comme une technique de transfert des obligations est placée dans les §398 et suivants du Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), dans la partie générale du droit des obligations, qui traite du droit des rapports d'obligations (contenu, formation, obligation contractuelle, extinction, reprise de dette, transfert de créance etc.). D'un côté, les deux systèmes juridiques sont proches. Héritiers d'une institution juridique très ancienne instituée par Justinien, ils encadrent le transfert de la chose incorporelle que constitue la créance, en facilitant la circulation des créances. Dans les deux cas, la cession conventionnelle d'un actif incorporel implique un changement de créancier sans affecter la créance elle-même; c'est donc la créance originaire qui est transférée sans aucune modification. Dans les deux pays, la cession de créance est très utilisée, qu'elle ait pour but la vente de la créance - c'est-à-dire l'opération d'escompte (cession dite spéculative), le paiement d'une dette (cession extinctive) ou la constitution d'une sûreté (cession fiduciaire). Pourtant, malgré ces ressemblances, le transfert de créance ne se réalise pas de la même manière en droit français et en droit allemand. Certaines différences existent qu'il n'est pas inutile de présenter. Afin de comparer les droits français et allemand de la cession de créance, la présente contribution étudie, dans un premier temps, les conditions de la cession de créance pour ensuite s'attacher à ses effets.
Oct 11, 2018
 Résumé / commentaire des auteurs:
Résumé / commentaire des auteurs:
La limitation du pouvoir de la Cour administrative fédérale à la clarification des seules questions de droit, justifiée au regard du droit procédural administratif général, est contreproductive dans la procédure juridictionnelle d'asile. Des discussions sont donc en cours au niveau politique pour déterminer s'il convient, par une modification des textes, d'attribuer à la Cour administrative fédérale un pouvoir limité d'enquête et de décision afin qu'elle puisse également contribuer à la sécurité et l'harmonisation juridiques sur des questions factuelles d'importance fondamentale.
Décisions abordées:
- Cour administrative fédérale, décision du 21 novembre 2017 - 1 C 39.16 (obligation faite aux juridictions d'établir l'existence d'une protection internationale accordée dans un autre État membre de l'Union européenne)
- Cour administrative fédérale, décision du 27 juin 2017 - 1 C 26.16 (questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne relatives aux migrations secondaires de bénéficiaires du statut de réfugié)
- Cour administrative fédérale, décision du 24 avril 2017 - 1 B 24.17 (irrecevabilité d'un pourvoi en cassation pour une question de fait d'importance fondamentale)

 Résumé :
Résumé :